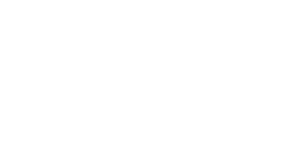C’est un honneur pour moi de me retrouver avec vous aujourd’hui à l’occasion de ce rassemblement de certains des esprits les plus brillants d’Afrique qui se sont réunis pour repenser les paradigmes de conservation existants afin de sauver notre Planète de la menace dévastatrice de la perte de biodiversité. Nous sommes ici pour répondre à une question fondamentale :
Pourquoi devons-nous soutenir et responsabiliser les peuples autochtones et les communautés locales, y compris les femmes et les jeunes au sein de ces communautés, pour atteindre les objectifs régionaux et mondiaux en matière de conservation de la biodiversité ?
Pendant des siècles, les gouvernements ont essayé et testé des approches traditionnelles de protection et de conservation des terres qui marquent la rupture entre l’homme et la nature. Cette approche a montré toutes ses limites. La diversité des espèces et des écosystèmes sur Terre décline à un rythme plus rapide qu’à n’importe quel autre moment de l’histoire de l’humanité : près d’un million d’espèces sont actuellement menacées d’extinction.
Depuis des années, nous avons entendu les experts mondiaux de la conservation dire aux gouvernements des pays du Sud, notamment de l’Afrique, d’étendre les aires protégées et d’augmenter le pourcentage de leurs territoires nationaux réservés à la conservation de la faune et de la biodiversité. Ces appels se sont multipliés récemment avec l’objectif de placer sous protection officielle au moins 30 %—et jusqu’à 50 %—des aires terrestres et marines de la planète à l’horizon 2030. C’est ce que l’on appelle désormais communément le Plan 30×30.
Force est de reconnaître que cette pratique de mise en réserve de grandes étendues de terres pour une conservation stricte s’est imposée pendant la période coloniale et est à l’origine de la création de certaines des aires de conservation les plus emblématiques du continent à savoir: Etosha (1907), Virunga (1925), Kruger (1926), Hwange (1928), Serengeti (1958) et Ngorongoro (1959).
Mais que signifie cette mise en réserve de terres à protéger, que ce soit par les gouvernements ou les organismes de conservation ? Contre quoi les protégeons-nous, et cela va-t-il résoudre la crise de la biodiversité de notre époque ?
Ces espaces se partagent un trait commun que sont les cas chroniques d’abus et de violations des droits de l’homme, illustrés par le déplacement de communautés, la perte de terres et la criminalisation subséquente des moyens de subsistance des communautés.
L’expulsion des indigènes Masaïs de certaines parties du nord de la Tanzanie dans le parc national de Ngorongoro au nom de la conservation et par souci de chasse aux trophées est un exemple patent des abus de la conservation en Afrique. Au moment où nous parlons, les peuples Benet du Mont Elgon en Ouganda sont expulsés de leurs terres traditionnelles. Les autorités chargées de la faune sauvage ont tiré sur des membres de la communauté, détruit leurs maisons et confisqué leur bétail.
Les violations des droits de l’homme et les expulsions forcées au nom de la conservation ne relèvent pas de l’histoire. Ce sont des pratiques en cours.
En effet, on estime que près de 136 millions de personnes ont été déplacées lors de la protection de la moitié des aires actuellement protégées de la Planète (8,5 millions de km2). Comme le montrent les recherches de RRI, les plus grandes menaces qui pèsent sur les « terres protégées » proviennent souvent de l’agriculture commerciale, des industries extractives, des émissions des projets industriels, et même parfois des acteurs censés les protéger.
La création d’aires protégées en Afrique ne s’est pas faite de manière isolée, mais a plutôt été fortement influencée par des processus mondiaux. En 1982, le Congrès mondial sur les parcs, qui s’est tenu à Bali, en Indonésie, a appelé à l’expansion d’un réseau d’aires protégées couvrant au moins 10 % de la surface terrestre de la planète, un objectif qui a donné la primauté au rôle des gouvernements dans la détermination, l’établissement et la gestion des programmes nationaux de conservation. Des engagements similaires ont été pris lors du sommet de Rio en 1992 avec la signature de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et l’adoption ultérieure des objectifs d’Aichi en matière de biodiversité en 2010.
Fondé sur la convention selon laquelle les gouvernements sont les meilleurs gardiens des biens communs, le réseau mondial des aires protégées a augmenté de 80 % entre 1970 et 1985, les deux tiers de cette croissance ayant eu lieu dans les pays en développement. Malgré cela, les objectifs d’Aichi en matière de biodiversité, fixés il y a 22 ans cette année, n’ont toujours pas été atteints. Aucun des objectifs de la CDB fixés en 1982, 1992, 2010 ou 2020 n’a été atteint.

Qu’est-ce que les nouvelles méthodes de mise en œuvre des efforts de conservation peuvent apporter à l’objectif 30×30 proposé ?
Il est temps que les décideurs politiques africains, les gouvernements occidentaux et les bailleurs de fonds de la conservation mondiale reconnaissent que la réponse à la crise mondiale de la biodiversité ne consiste pas à vider les forêts de leurs gardiens traditionnels, mais à reconnaître les droits de ces derniers et leur leadership dans la protection de ces forêts, et à investir dans leurs efforts de conservation. Plus de cinq décennies de recherche montrent que les terres communautaires légalement reconnues stockent plus de carbone, génèrent beaucoup moins d’émissions et de déforestation, et soutiennent les moyens de subsistance d’un plus grand nombre de personnes que les terres administrées par des gouvernements ou des entités privées.
Les peuples autochtones et les communautés locales revendiquent près de 50 % des terres de la planète, mais leurs droits de propriété ne sont reconnus que sur 10 % de cette superficie, alors que la majeure partie de la biodiversité restante de la Planète se trouve sur leurs terres et territoires.
Les recherches de RRI montrent que la conservation basée sur les droits est une solution viable et rentable pour atteindre l’objectif 30×30. En effet, le rapport révèle qu’il est bien plus coûteux de relocaliser les populations locales que de leur donner des droits et des outils pour conserver leurs terres.
Malgré les difficultés liées à la pauvreté et aux injustices structurelles, les peuples autochtones et les communautés locales réalisent des investissements de l’ordre de 2 à 4 milliards de dollars par an, tout en gérant et en protégeant la biodiversité plus efficacement et à moindre coût que toute autre entité du secteur public ou privé. Ils y parviennent sans soutien, ni reconnaissance ou financement appropriés, ce qui fait de la question des droits fonciers sécurisés des peuples autochtones et des communautés locales une alternative juste et viable aux pratiques de conservation marquées par l’exclusion.
Voici cinq recommandations à l’intention des gouvernements et des responsables politiques de l’APAC:
-
- Promouvoir la reconnaissance juridique et la protection des droits fonciers et forestiers des peuples autochtones et des communautés locales, y compris des femmes et des jeunes au sein de ces communautés ;
- Renforcer et promouvoir les approches et les modèles de conservation fondés sur les droits en Afrique ;
- Mettre en place un mécanisme indépendant et transparent de suivi de la conservation et de réclamation à l’échelle de l’Afrique afin de renforcer les efforts de conservation, de réparer les violations des droits de l’homme et de faire respecter les règles édictées en la matière ;
- Soutenir les efforts déployés par les jeunes et les femmes des communautés pour faire valoir leurs droits à la terre et aux moyens de subsistance dans les zones importantes pour la conservation de la biodiversité ;
- Canaliser davantage de fonds de conservation directement vers les peuples autochtones et les communautés locales, y compris les femmes et les jeunes de ces communautés.
Pour conclure, permettez-moi de poser la question suivante : est-il possible de continuer à appliquer le modèle de conservation habituel en Afrique ? Existe-t-il des modèles alternatifs qui peuvent et doivent être envisagés pour atteindre les objectifs de biodiversité et de conservation sur le continent?
La réponse est manifestement oui. Nous devons tirer parti de la diversité culturelle de l’Afrique pour élaborer de nouveaux modèles de conservation qui placent l’homme au centre de la nature. Les peuples autochtones et les communautés locales sont des alliés essentiels dans la lutte pour la protection de notre planète et il est grand temps de les mettre en avant. Les terres ont des habitants et les habitants ont des droits. Nous devons protéger les deux.