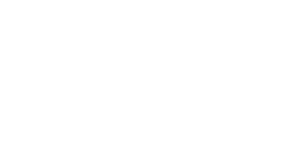Lorsque les gouvernements ont signé le Cadre mondial pour la biodiversité (CMB) de Kunming-Montréal en 2022, ils se sont engagés à protéger 30 pour cent des terres, des eaux et des mers de la planète d’ici 2030. Le CMB a par ailleurs reconnu un principe plus fondamental : la conservation ne peut pas réussir sans les droits, l’impulsion et les connaissances des peuples autochtones, des peuples afro-descendants et des communautés locales.
Aujourd’hui, un nouveau rapport publié conjointement par RRI, Forest Peoples Programme et le Consortium ICCA, qui évalue 30 pays à forte biodiversité en Afrique, en Asie et en Amérique latine, montre que si la plupart des pays disposent de voies juridiques pour faire progresser la conservation fondée sur les droits, dans la pratique, les contributions des communautés aux efforts nationaux de conservation continuent d’être insuffisamment reconnues ou soutenues.
Dans de nombreux pays, les communautés qui gèrent les terres, les forêts et les rivières depuis des générations ne bénéficient toujours pas de la reconnaissance juridique et des garanties qu’elles méritent et dont elles ont besoin pour survivre et poursuivre leur travail essentiel.
Le rapport identifie cinq opportunités à saisir pour que les pays puissent tenir les promesses du CMB :
-
Il existe des voies pour reconnaître légalement la conservation menée par les communautés, mais elles restent sous-utilisées et insuffisantes. Vingt-six des 30 pays disposent d’au moins une voie juridique qui pourrait permettre aux communautés de poursuivre dans les zones protégées une conservation sous leadership communautaire qui soit officiellement reconnue; et 29 disposent de voies potentielles, au moyen des régimes fonciers communautaires, susceptibles de permettre aux communautés d’obtenir cette reconnaissance dans le cadre des Autres mesures efficaces de conservation par zone (OECM) et des Territoires autochtones et traditionnels (TAT). Cependant, la plupart des pays ne disposent pas des cadres politiques ou juridiques nécessaires pour reconnaître les TAT ou la conservation communautaire dans le cadre des OECM en tant que voies distinctes et complémentaires pour tenir les engagements nationaux pris au titre de l’objectif 3 du CMB.
-
Malgré une multiplication des réformes législatives depuis 2015, les possibilités d’une mise en œuvre efficace de la conservation communautaire restent mitigées. Si certaines lois nouvelles ont renforcé les droits des communautés au cours de la dernière décennie, d’autres les ont affaiblis, ce qui montre bien la fragilité du cadre juridique avec lequel les communautés doivent se débattre pour exercer la gestion responsable de leurs territoires.
-
Le consentement libre, informé et préalable (CLIP) reste insuffisamment protégé. Moins de la moitié des 30 pays analysés reconnaît le CLIP comme un droit opposable, ce qui laisse les communautés exposées aux violations de leurs droits dans un contexte où les pays cherchent à étendre leurs systèmes de zones protégées pour atteindre les objectifs de conservation fixés dans le CMB.
-
La législation protège mal les droits des femmes des communautés, ignorant leur rôle clé dans la gouvernance communautaire et les initiatives de conservation. Malgré leur rôle central dans la gouvernance et la conservation, les femmes autochtones, afro-descendantes et des communautés locales bénéficient rarement d’une égalité de droits en matière de participation, de vote ou de leadership dans les cadres juridiques existants.
-
La reconnaissance des droits communautaires dans les Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) — principaux instruments nationaux de mise en œuvre du CMB — varie considérablement d’un objectif à l’autre. Seuls 12 des 30 pays étudiés adoptent explicitement une approche fondée sur les droits humains dans leurs SPANB, et les droits des communautés sur leurs territoires ainsi que leurs droits en matière de partage des avantages, de participation, d’accès à la justice et à l’information, entre autres, restent insuffisamment protégés dans l’ensemble des pays.
Ces lacunes sont importantes. En l’absence de droits fonciers garantis et de protections juridiques solides, les démarches de conservation risquent de répéter les erreurs du passé et d’entraîner le déplacement des communautés au nom de la protection de la nature. Néanmoins, le rapport met également en évidence des opportunités : presque tous les pays étudiés disposent de voies potentielles pour une conservation menée par les communautés. Ce qu’il faut maintenant, c’est de la volonté politique, des investissements et des partenariats.
L’expérience de trois communautés, situées en Afrique de l’Est, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, montre les enjeux et les possibilités.
Madagascar : Les femmes à la tête de la conservation des mangroves
Dans la région de Loky Manambato, au nord-est de Madagascar, les mangroves ont autrefois souffert de la surexploitation, laissant les familles de pêcheurs avec des prises et des revenus en baisse. Face à ces défis, les femmes du village d’Ampasimadera ont décidé de s’organiser. Elles ont formé des associations pour restaurer et gérer les mangroves, une démarche inhabituelle dans une société où le rôle des femmes se limite souvent aux tâches domestiques.
Aujourd’hui, avec le soutien de Fanamby, quatre associations de femmes administrent plus de 1,000 hectares de mangroves et en ont restauré près de 20 hectares. Leurs efforts ont permis de relancer les populations de crabes, de crevettes et de poissons, d’augmenter les revenus des familles et de créer de nouveaux moyens de subsistance grâce au tissage et à l’artisanat. Les revenus mensuels des participantes oscillent désormais entre US$25 et US$55, ce qui est considérable dans la région.
Le succès de ces initiatives menées par des femmes montre comment l’autonomisation des femmes au sein des communautés peut permettre à la fois la conservation et la résilience économique. Loky Manambato est désormais considérée comme un modèle, le leadership des femmes étant essentiel à la sauvegarde des écosystèmes côtiers de Madagascar.

Guyane : Protéger la conservation communautaire du wiizi Wapichan
En Guyane, le peuple Wapichan protège ses forêts depuis des générations, en particulier la zone des sources qui alimente son territoire en eau. Pourtant, le gouvernement n’a jamais officiellement titularisé ces terres, laissant le peuple Wapichan vulnérable à l’accaparement foncier et exclu des processus décisionnels.
Le CMB offre une opportunité de changer cela. Le Guyana s’est engagé à doubler ses zones protégées d’ici 2025 et à atteindre l’objectif 30×30. Mais pour y parvenir, le gouvernement doit reconnaître les efforts des Wapichan comme des contributions légitimes. Le peuple Wapichan a élaboré des Plans de durabilité au niveau local et un Plan de gestion territoriale pour officialiser son engagement en faveur de la conservation de ses territoires. Le Conseil du district sud de Rupununi est déjà en dialogue avec les autorités, les exhortant à reconnaître leur conservation des sources fluviales.

Philippines : 50 ans de gestion communautaire en héritage
Il y a un demi-siècle, le peuple Ikalahan du nord des Philippines était menacé d’expulsion de ses forêts ancestrales. Plutôt que de partir, il s’est organisé. Avec l’aide d’un avocat, il a créé en 1973 la Fondation éducative Kalahan (KEF) et a conclu un accord historique avec le gouvernement pour gérer ses terres sous l’appellation de Réserve forestière de Kalahan.
À l’époque, cette initiative était révolutionnaire : la conservation par et pour le peuple. Les Ikalahan ont conjugué les connaissances autochtones et des approches scientifiques pour cartographier leur territoire, désigner les zones de sources fluviales et protéger les habitats des oiseaux. Ils ont transformé les produits forestiers non ligneux en moyens de subsistance communautaires, en créant ainsi des emplois tout en gardant les forêts sur pied.
Cinquante ans plus tard, la KEF continue d’administrer les terres, prouvant qu’en réalité les droits communautaires, loin d’être un obstacle à la conservation, en sont le fondement.

Transformer les engagements en actions
De Madagascar à la Guyane en passant par les Philippines, ces histoires montrent que la conservation fondée sur les droits n’est pas seulement possible : elle est déjà une réalité. Mais trop souvent, les communautés réussissent malgré les obstacles juridiques plutôt que grâce à eux.
Les gouvernements, les bailleurs de fonds et les organisations de conservation sont désormais confrontés à un choix : adopteront-ils la conservation impulsée par les communautés autochtones, afro-descendantes et locales comme pierre angulaire du CMB, ou continueront-ils à marginaliser celles et ceux qui protègent la biodiversité depuis des siècles ?
La réponse à cette question déterminera si la promesse du 30×30 va devenir un nouvel objectif de conservation imposé par le haut ou bien une étape véritablement transformatrice dans le sens de l’équité, la justice et la durabilité.
Nous avons identifié six opportunités que les pays peuvent saisir pour pouvoir atteindre l’objectif 30×30 du Cadre mondial pour la biodiversité :
-
Reconnaître les terres et les territoires communautaires : Les états doivent garantir les droits fonciers des communautés et respecter les priorités autodéterminées par celles-ci en matière de conservation, tout en veillant à ce que les lois et les politiques nationales de conservation ne viennent pas diluer, contredire ou annuler ces garanties.
-
Reconnaître les Territoires autochtones et traditionnels (TAT) en tant qu’échelon distinct de conservation : Les états doivent mettre en place les mécanismes nécessaires pour inclure et signaler les TAT au sein des zones de conservation reconnues au niveau national dans le cadre de l’Objectif 3 du CMB.
-
Faire respecter le CLIP : Les pays doivent garantir des droits clairs et opposables en matière de CLIP et de participation effective, tant dans les textes que dans la pratique.
-
Garantir l’égalité des droits pour les femmes : Les pays doivent réformer toutes les lois et politiques applicables afin de garantir explicitement l’égalité des droits des femmes en matière de participation à toutes les décisions relatives à la conservation, y compris leurs droits de participation, de vote et de leadership au sein des communautés.
-
Veiller à ce que les SPANB suivent une approche fondée sur les droits : Les SPANB doivent être élaborées et mises en œuvre en partenariat avec les communautés afin de garantir le respect de leurs droits dans toutes les cibles nationales ; cela suppose la mise en place de cibles mesurables en matière de conservation à base communautaire pour remplir les conditions de l’Objectif 3.
-
Combler le fossé entre les politiques et leur mise en œuvre :
Les réformes législatives et politiques fondées sur les droits doivent être suivies d’actions concrètes afin que le fossé entre les textes et la pratique puisse être comblé.