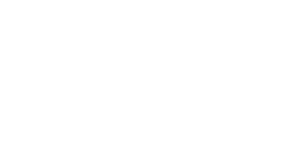Washington, D.C. (30 septembre 2025)—Près de deux décennies après l’adoption mondiale de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) et 10 ans après le lancement des objectifs de développement durable (ODD), un nouveau rapport par L’Initiative des droits et ressources (RRI) révèle que la protection juridique des droits forestiers communautaires dans le cadre de la législation nationale reste dangereusement insuffisante.
Malgré la reconnaissance mondiale croissante du rôle fondamental que jouent les peuples autochtones, les peuples afro-descendants et les communautés locales dans la gestion des forêts mondiales, et malgré des décennies de plaidoyer de la part des titulaires de droits et de leurs alliés, de nombreux gouvernements n’ont pas réussi à traduire les engagements internationaux en une législation nationale solide et applicable. Il en résulte un fossé toujours plus profond entre la reconnaissance juridique et la mise en œuvre pratique des droits forestiers, tandis que des niveaux sans précédent de violence et de criminalisation, de déplacements et d’accaparement des terres, d’érosion de l’espace civique et de réduction de l’aide continuent de mettre les droits humains de ces communautés en danger.
« Les preuves sont claires. Même si nous observons des progrès mondiaux dans la reconnaissance des droits sur le papier, cette reconnaissance ne progresse pas de manière cohérente au niveau national et nous ne constatons pas d’actions équivalentes là où cela compte le plus : dans la réalité quotidienne des communautés, » a déclaré Chloe Ginsburg, directrice adjointe du programme Suivi de la tenure chez RRI et co-auteure du rapport. « Il ne s’agit pas seulement d’un vide juridique. C’est une crise de la justice et une crise climatique. »
Une décennie de progrès mitigés
Le rapport, intitulé Semer les réformes, est l’étude la plus complète réalisée à ce jour par RRI sur les droits fonciers communautaires forestiers. Il évalue 104 cadres juridiques dans 35 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, régions qui regroupent environ 80 pour cent des forêts de ces trois régions et 42 % de la superficie forestière mondiale.
S’appuyant sur plus d’une décennie de suivi des droits fonciers, cette analyse offre un aperçu sans précédent de l’état, de la force et de l’évolution des droits forestiers communautaires, tout en mettant en évidence les lacunes juridiques qui continuent de menacer la gestion communautaire en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Depuis l’adoption des ODD en 2015, 11 nouveaux cadres juridiques reconnaissant les droits forestiers communautaires ont été adoptés dans sept pays, principalement en Afrique.
Mais le rapport avertit que ces progrès ne sont pas aussi prometteurs qu’ils le semblent. Il montre en effet que la multiplication des cadres juridiques ne se traduit pas nécessairement par un renforcement des droits des communautés. En réalité, les droits les moins protégés, tels que la possibilité d’exclure des tiers ou de détenir des terres à perpétuité, sont les plus essentiels pour garantir une gestion durable et intergénérationnelle.
La plupart de ces réformes juridiques ne garantissent pas non plus la pleine propriété. Seuls cinq des 11 cadres nouvellement reconnus depuis 2016 accordent aux communautés l’ensemble des droits nécessaires pour être considérées comme les propriétaires légaux de leurs forêts. Les autres sont insuffisants, car ils ne garantissent pas un contrôle réel sur l’utilisation des terres, la gouvernance ou la protection contre les empiètements extérieurs.
Un écart croissant entre la reconnaissance et la réalité
Le rapport brosse un tableau sombre de la lenteur et de l’incohérence des progrès nationaux, malgré l’extension continue des protections prévues par le droit international et des décennies de plaidoyer de la part des titulaires de droits et de leurs alliés.
Alors que près de la moitié (46 %) des cadres juridiques évalués ont été réformés entre 2016 et 2024, seuls trois d’entre eux ont abouti à une extension significative des droits communautaires, tandis que d’autres ont connu des reculs.
Aujourd’hui, moins de la moitié (42 %) de tous les cadres reconnaissent pleinement les communautés comme propriétaires forestiers en vertu du droit national. Même lorsque les droits sont reconnus sur le papier, un écart critique subsiste entre la reconnaissance juridique des droits fonciers et la mise en œuvre de ces droits dans la pratique.
« Le fossé entre la reconnaissance juridique et les réalités vécues par les communautés et les femmes des communautés les rend vulnérables aux violations de leurs droits et à l’empiètement sur leurs territoires, d’autant plus que les pressions liées au climat, à la conservation et au développement s’intensifient parallèlement à la montée de l’autoritarisme et au rétrécissement rapide des espaces civils dans les pays du monde entier. » a déclaré Isabel Davila Pereira, analyste juridique pour RRI et co-auteure.
Protections incomplètes pour les communautés et les femmes
Le rapport souligne également le manque persistant de protections pour les femmes autochtones, afro-descendants et issues des communautés locales. Seuls deux cadres protègent explicitement le droit des femmes à voter dans la gouvernance locale, et seuls cinq garantissent leur droit à participer à la direction de la communauté. La plupart des lois restent muettes sur l’inclusion du genre, alors même que les femmes jouent un rôle essentiel dans la gestion des forêts et la transmission intergénérationnelle des connaissances.
En outre, si presque tous les cadres juridiques autorisent une certaine forme d’utilisation des forêts par les communautés, la reconnaissance juridique de l’importance culturelle, spirituelle et religieuse des zones forestières fait souvent défaut. Cela nuit à la pleine expression de la relation des communautés avec leurs terres, qui sont essentielles non seulement à leur bien-être, mais aussi à leur gestion des forêts.
Pour la première fois, le rapport évalue dans quelle mesure les lois nationales respectent le droit au consentement libre, informé et préalable (CLIP), un droit fondamental en vertu du droit international. Les conclusions sont préoccupantes : seule la moitié des cadres juridiques reconnaissent le CLIP, et ceux qui le font utilisent souvent un langage vague qui limite son application pratique et laisse la porte ouverte à l’exploitation par des acteurs gouvernementaux ou privés.
Si 82 % des cadres reconnaissent une certaine forme de procédure régulière et de droit à indemnisation, près d’un tiers d’entre eux ne prévoient que le droit à un recours judiciaire, sans exiger de notification préalable ni de consultation des communautés concernées. Cela ne répond pas aux normes internationales en matière de droits humains et laisse les communautés avec peu de moyens pour contester l’accaparement des terres ou les déplacements forcés.
« Il ne s’agit pas seulement de terres. Il s’agit de justice, d’autonomie et de survie, » a déclaré Léonie Ngalula Mputu, responsable des questions de genre à la Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones (DGPA) en République démocratique du Congo. « Il est urgent que les gouvernements prennent des mesures coercitives pour appliquer les lois existantes. Ne pas le faire revient à ne pas garantir les protections les plus élémentaires aux communautés qui protègent les écosystèmes les plus vitaux de la planète. »
Un tournant pour le climat, les droits et la justice
Les tendances actuelles, notamment l’essor de l’extractivisme à grande échelle, les initiatives climatiques « vertes » de façade, les répressions autoritaires et le rétrécissement de l’espace civique, aggravent les lacunes juridiques et menacent les modestes progrès réalisés au cours des deux dernières décennies.
Pourtant, des solutions sont à portée de main. Les cadres juridiques qui reconnaissent les droits coutumiers et communautaires offrent systématiquement une protection plus solide que les modèles axés sur la conservation ou l’utilisation. Lorsque les gouvernements mettent en œuvre des cadres qui reflètent véritablement les réalités de la gouvernance collective des terres, en particulier ceux qui accordent une place centrale au rôle des femmes, les résultats pour les forêts, les populations et la planète s’améliorent.
À seulement cinq ans de l’échéance des ODD, le rapport exhorte les gouvernements, les bailleurs de fonds, la société civile et le secteur privé à agir de manière décisive.
« Ce rapport confirme ce que les peuples autochtones, les peuples afro-descendants et les communautés locales affirment depuis longtemps : la reconnaissance doit être plus que symbolique, » a conclu Chloe Ginsburg, de RRI. « À mesure que l’action climatique s’accélère, les protections juridiques accordées à ceux qui protègent les forêts du monde doivent également s’accélérer. La communauté internationale ne peut se permettre de laisser ces communautés de côté. Leurs droits ne sont pas une note de bas de page de l’action climatique. Ils en sont le fondement. »